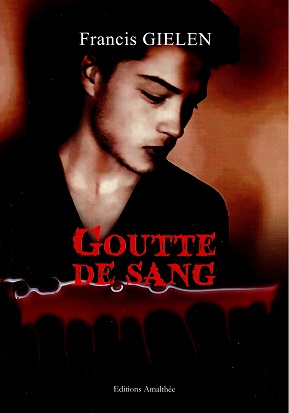
Fuir (2/4)
Soudain une violente douleur me projette à terre, quelqu'un m'a tiré dans le dos ! Je me retourne :
devant moi, surgi du néant, un colosse en uniforme me pointe une mitraillette sur le corps. C’est
avec le canon de son arme qu'il m’a propulsé au sol.
Ce petit trou noir, c’est la mort. Nous ne nous sommes jamais vus, je ne lui ai rien fait et il veut me
tuer, je n'y comprends rien. Je rampe pour lui échapper, mais il me fait signe de me lever ; pour sûr
il ne plaisante pas !
Sa moustache est impressionnante, elle me rappelle les illustrations de mon livre d’histoire, la moustache
des anciens Gaulois. Une affreuse cicatrice lui enlaidit le visage. Son uniforme usagé lui donne
l'allure d'un vieux baroudeur. Je décide de l'appeler « Balafre ».
Je lui obéis et je lève les mains. Balafre me guide vers la maison communale. Je ne comprends pas sa
violence, je ne suis qu’un enfant. Je lui dis : « Laissez-moi tranquille ! J’irai où vous voudrez,
mais ne me frappez pas ! » Mais visiblement il ne comprend pas le français.
Balafre me mène dans une petite pièce. Un soldat est assis devant une table, sur laquelle je vois des
cartes à jouer, des canettes de bière et une trompette, celle d'« Il silenzio » !
Ils discutent avec animation, je ne comprends pas un mot. Balafre prend l'ascendant, c'est une véritable
force de la nature avec plein de tatouages sur les bras. Je remarque un tatouage récent, un cœur brisé,
signe d'un chagrin d'amour.
L'autre soldat est en retrait. Ses lunettes lui donnent un air faussement intelligent, son uniforme est
négligé. Je décide de l'appeler « Trompette ».
Brusquement Balafre m’empoigne le bras et le serre très fort. Je panique, je me débats, je tape au
hasard et je crie : « Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Je ne veux pas ! » Balafre me projette vers le mur.
Vivement je place les mains devant la tête et mes paumes claquent sur le plafonnage.
Quelle brute ! La douleur s’irradie dans le dos. Balafre me tient en position pendant que Trompette me
fouille de la tête aux pieds. Je me laisse faire, j'ai trop peur, je me plains à voix basse :
« J'ai rien fait. Laissez-moi tranquille ! »
Ils se taisent. Vu ma tenue, la fouille n'est pas longue. Trompette me retire mes baskets. Mes paupières
se gonflent de larmes, mais je les contiens, car je ne veux pas pleurer devant eux.
Ils regagnent leurs chaises et me laissent dans mon inconfortable position, penché en avant, les mains
contre le mur. Ils jouent aux cartes et boivent de la bière. Je n’ose pas me redresser, je n’ose pas
bouger, c'est à peine si j'ose respirer.
Pourquoi me traitent-ils si durement ? Nous ne nous connaissons pas, je ne leur ai rien fait et même envers
leur pire ennemi, ils ne seraient pas aussi féroces. Dans la pièce règne l’écœurante odeur des casernes,
l’âcre fumée de cigarette, une odeur de mouffette et des relents de pain moisi et d’urine.
Des fourmis me courent dans les jambes, mes bras sont raides et douloureux. Qu’ils se décident vite ! Je
les regarde, ils ne m'accordent aucune attention. Je me redresse un peu, mais une brutale interjection
de Balafre me fige sur place.
Alors je me déplace lentement, imperceptiblement afin de diminuer la gêne. De toute manière ma capture est
une erreur, ils vont sûrement me relâcher. Mais un tremblement convulsif me parcourt le corps à l'idée
qu’ils vont peut-être me tuer.
Un militaire entre dans la pièce, les soldats se mettent au garde-à-vous. C'est leur chef, son uniforme
le prouve ! Alors que celui de Balafre est usagé et que celui de Trompette est négligé, celui du
nouveau venu est impeccable. Il sort du teinturier.
Je suis ébloui par la blancheur de ses gants. Je décide de l'appeler « Gants-blancs ». Comment parvient-il
à garder des vêtements si bien calandrés en pleine guerre ?
Ils parlent entre eux, je n'y comprends rien. Brusquement Gants-blancs s'adresse à moi.
- Ton nom ?
- Olivier Delval, Monsieur. Je suis innocent, je vous le jure.
Il ne m’écoute pas, il donne des ordres. Les soldats se jettent sur moi, me ramènent les bras dans le dos
et me lient les poignets. Puis ils m'emmènent à la cave, ils ouvrent une porte et me jettent sur le
sol bétonné d’un réduit. Le pêne grince en glissant dans la gâche.
Après quelques essais infructueux, je parviens à m'asseoir. Ces soldats sont trop méchants ! La peur ne
me quitte plus depuis que je suis revenu au village.
Comment m’évader ? Je dois d’abord me délier. Je tends et détends la corde dans l'espoir d'élargir une
boucle, je dois réussir avant que le poignet gonfle. Je serre les dents, je tords les liens en tous
sens en dépit de la douleur.
Comme cela ne donne rien, je me couche sur le côté et je passe les poignets derrière les fesses jusqu'aux
genoux, puis je dégage une jambe après l'autre. Les poignets sont à présent devant moi. Je m'assieds
et je défais les nœuds avec les dents.
Bientôt mes mains sont libres. Je masse les écorchures laissées par le chanvre.
Les salauds ! Ils m’ont eu ! Ils vont me tuer, c’est sûr. Je n’aurais pas dû m’affoler, ni fuir vers
la maison communale. C’était de la folie. J’aurais dû me cacher dans ma chambre, m’enfouir sous mes
draps et n’en plus bouger jusqu’à ce que l’armée de libération arrive.
Mais à quoi bon ces regrets ! Je suis leur prisonnier, ils feront de moi ce qu'ils veulent, je ne peux pas
les en empêcher ! Je me couche sur le béton, je pleure, puis j'éclate en sanglots, je ne parviens plus
à retenir mes larmes.
Une fois calmé, je me gourmande. Mes parents me gronderaient pour mes pleurnicheries. Je dois me battre.
Si j’en sors vivant, je serai plus fort. D’ailleurs ils ne me tiennent pas encore, je trouverai
sûrement un moyen de m'évader.
